Le quotidien du Roussillon du 1er mars 1884 nous informe brièvement de la mort dramatique d'un torero dans les arènes de Céret.
Mort d'un toréador : Le 24 février, un toréador surnommé le Gavatj a été tué par le taureau dans une course qui avait lieu à Céret. Le Gavatj était un des amateurs qui réussissaient le plus souvent à gagner la prime de 20fr. en enlevant la cocarde du taureau emboulé, dans les arènes de Perpignan. Il est mort deux jours après l'accident qui lui était survenu, et au milieu d'atroces souffrances.
De la même manière, le bi-hebdomadaire Le Canigou dans son numéro double du mercredi 27 février / samedi 1er mars 1884 nous donne sa version des faits avec quelques variantes.
La course de taureaux qui a eu lieu dimanche dernier à Céret a été le théâtre d'un drame horrible. Le toréador Gabatj (mot dont les Espagnols se servent pour désigner ironiquement un Français) a été presque empalé par un coup de corne qui lui est entré dans le corps à 25 centimètres de profondeur.
Ce malheureux toréador est mort mercredi après trois jours de souffrances atroces.
On peut donc déduire d'après cet article que le pauvre toréador a donc été empalé le dimanche 24 et est mort le mercredi le 27 février 1884.
L'hebdomadaire perpignanais Al Galliner du 9 mars 1884 revient sur cette affaire en donnant plus de détails sur la vie de ce torero, dont on ne saura par ailleurs que le surnom de Gavatj ou Gavach, mais jamais le nom véritable. Bien qu'encore jeune, ce n'était pas un novice, ayant débuté très tôt, mais l'embonpoint qu'il aurait développé au cours des années semble avoir causé sa perte. L'événement est d'autant plus tragique que ce torero devait se marier le lendemain. Le journaliste en profite aussi pour répondre aux détracteurs des courses de taureaux.
Mort d'un toréador : Le 24 février, un toréador surnommé le Gavatj a été tué par le taureau dans une course qui avait lieu à Céret. Le Gavatj était un des amateurs qui réussissaient le plus souvent à gagner la prime de 20fr. en enlevant la cocarde du taureau emboulé, dans les arènes de Perpignan. Il est mort deux jours après l'accident qui lui était survenu, et au milieu d'atroces souffrances.
De la même manière, le bi-hebdomadaire Le Canigou dans son numéro double du mercredi 27 février / samedi 1er mars 1884 nous donne sa version des faits avec quelques variantes.
La course de taureaux qui a eu lieu dimanche dernier à Céret a été le théâtre d'un drame horrible. Le toréador Gabatj (mot dont les Espagnols se servent pour désigner ironiquement un Français) a été presque empalé par un coup de corne qui lui est entré dans le corps à 25 centimètres de profondeur.
Ce malheureux toréador est mort mercredi après trois jours de souffrances atroces.
On peut donc déduire d'après cet article que le pauvre toréador a donc été empalé le dimanche 24 et est mort le mercredi le 27 février 1884.
L'hebdomadaire perpignanais Al Galliner du 9 mars 1884 revient sur cette affaire en donnant plus de détails sur la vie de ce torero, dont on ne saura par ailleurs que le surnom de Gavatj ou Gavach, mais jamais le nom véritable. Bien qu'encore jeune, ce n'était pas un novice, ayant débuté très tôt, mais l'embonpoint qu'il aurait développé au cours des années semble avoir causé sa perte. L'événement est d'autant plus tragique que ce torero devait se marier le lendemain. Le journaliste en profite aussi pour répondre aux détracteurs des courses de taureaux.
La mort d'un torero
Le jeune torero qui vient de mourir à la corrida de Céret était né à Fitou, département de l'Aude. Il fut nourri à Arles-sur-Tech, où on lui donna le surnom de gavach, qualificatif par lequel (comme le fait justement remarquer Le Républicain) les catalans du Roussillon et d'Espagne désignent les Languedociens. Fixé dans la capitale du Vallespir, il reçut de son père nourricier les premières leçons de tauromachie ; la témérité du maître devait déteindre sur l'élève.
Nous avons vu le gavach, il y a quelques années, aux courses de St-Laurent-de-Cerdans, il était alors maigre, nerveux, d'une agilité extraordinaire, bondissant autour du taureau sans la moindre capa pour se protéger, enlevant les cocardes. L'audace qu'il déploya ce jour-là, montra aux nombreux aficionados que le jeune torero périrait de son imprudence.
Modeste autant que courageux, il dédaignait les fanfaronnades auxquelles nous ont habitué les toréadors-acrobates nîmois et en particulier le fameux Pouly. Il pratiquait et connaissait l'art de la tauromachie et non les exercices de cirque.
Nous l'avons revu plus tard aux courses de Perpignan, mais l'embonpoint lui avait enlevé la plupart de ses facultés, il avait de la peine à gagner rapidement la barrera, plus encore à la franchir. Grâce à son courage, il enlevait néanmoins les cocardes ; comme banderillero c'était un homme fini, la première des qualités étant de présenter une superficie aussi faible que possible aux cornes du taureau. C'est en posant des banderillas que le malheureux a trouvé la mort.
Son mariage devait être célébré le lendemain; en vain sa fiancée agitée par un sombre pressentiment l'avait-elle suppliée de ne point descendre dans l'arène ; il jura que c'était la dernière fois et voulut en offrant les cocardes à son estimada lui donner en présence de la foule une preuve éclatante d'affection. Encore une fois les pressentiments se réalisèrent, le torero fut tué presque au début de la course.
A cette nouvelle les journaux de Paris et du Nord ont poussé des cris de paon. Qu'on défende les courses de taureaux et toute la rengaine connue. Ah bien oui, si l'on veut prohiber ce genre de spectacle que l'on prenne une mesure semblable pour les courses de chevaux, les régates et l'entrée des dompteurs dans les cages de bêtes fauves.
Parce qu'il est de bon goût, parce que la haute futaie affectionne les courses de chevaux, on ne prête qu'une légère attention aux nombreux jockeys qui chaque année s'estropient, se tuent au saut des obstacles et des rivières. C'est très chic, très v'lan, cela suffit.
Quoi de plus barbare et de plus digne des Romains de la décadence que le spectacle d'un homme qui chaque soir s'expose à être dévoré par une bête féroce ? Il est là sans défense, sans moyen de fuite en présence d'un public sans enthousiasme et glacé d'horreur. - Aux courses de taureaux, l'homme peut fuir et peut-être dégagé par ceux qui composent la cuadrilla, des milliers de personnes assistent aux triomphe du torero, le danger est en quelque sorte atténué par la beauté, la grandeur du spectacle.
On peut reprocher aux courses espagnoles le massacre des chevaux, mais telles qu'elles se pratiquent en Roussillon les courses n'offrent rien qui puissent justifier les réclamations d'une minime partie de la presse. Et d'ailleurs si l'on peut prouver que la mort d'un torero est chose excessivement rare, en est-il ainsi des dompteurs ?
Ces derniers finissent toujours par être dévorés et l'on connait bien des toreros en renom qui jouissent maintenant de la fortune acquise pendant leur jeunesse. La proportion est de cinq à un, nous n'inventons rien.
Si l'on veut donc défendre les courses de taureaux, il ne peut y avoir deux poids et deux mesures, que l'on fasse table rase du coup.
Un aficionado
Note 1 : Le journaliste d'Al Galliner se plaint dans son article des réactions de la presse nationale suite à cet accident, bien que j'avoue avoir cherché et n'avoir rien trouvé dans les divers journaux à grand tirage de cette époque (ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien).
Note 2 : Il s'agit bien ici de courses de taureaux, puisque qu'à Céret la première corrida à l'espagnole avec mise à mort n'aura lieu qu'en 1894, soit dix ans plus tard.
Sources :
* Le Roussillon du 1er mars [domaine public] (via le fonds numérisé de la médiathèque de Perpignan)
* Le Canigou du 27 février / 1er mars 1884 [domaine public] (via le fonds numérisé de la médiathèque de Perpignan)
* Al Galliner du 9 mars 1884 [domaine public] (via le fonds numérisé de la médiathèque de Perpignan)
Photo : Fabricio Cardenas [cc-by-sa]
Ce blog vous intéresse ? Vous pouvez vous y abonner
en bas à droite de cette page dans la section Membres.
Cet article vous a intéressé ? Partagez-le !
en bas à droite de cette page dans la section Membres.
Cet article vous a intéressé ? Partagez-le !



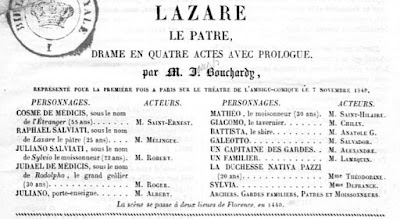















.jpg)
