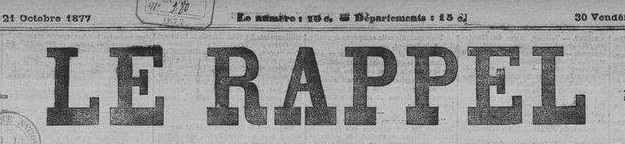Je poursuis avec la commune de Corbère mes retranscriptions concernant les archives de la période des Cent-Jours en 1815 dans le département des Pyrénées-Orientales. Nous allons voir qu'à l'instar de la plupart des communes déjà traitées, le maire de Corbère a dû, lui aussi, laisser sa place à un sujet sans doute plus fidèle à l'Empereur en ce 10 juin 1815.
Note : il me manque la fin du document, donc je n'ai pas pu constater si les maires ancien et nouveau savaient signer, les cas d'illettrisme étant encore fréquents à cette époque, même parmi les élus.
 |
| Nous soussignés Membres du Conseil Municipal de la Commune de Corbere... |
Commune de Corbère
L'an Mille huit cens quinze et le dix du Mois de juin
Nous soussignés Membres du Conseil Municipal
de la Commune de Corbere assembles à la Maison
Commune d'après l'invitation de Monsieur Llech
Sébastien Maire pour nous assembler, [ci étant]
Mr le Maire nous a communiqué qu'il est
remplacé par Joseph Pons Tixador nommé Maire
par l'assemblee primaire, M Boniface Roig adjoint
nommé aussi par l'assemblée primaire
qui a eu lieu le vingt cinq mai dernier, [y ont]
obtenu plus que la moitié des votes, et que
d'après l'arrete de M le prefet en datte du
trois juin les dits Pons Tixador et Boniface Roig
doivent etre installes, et par consequent preter
le serment prescrit par l'article 56 du Senatus
Consulte du 28 floreal an douze, et tout de suite
ont aussi comparu les sudits Pons Tixador Joseph
et Roig Boniface qui ont preté le serment
qui suit je jure obeissance aux constitutions
de l'Empire et fidelité à l'Empereur...
Le secrétaire ayant enregistré les événements est inconnu, mais il écrit correctement et sans fautes (par rapport à l'orthographe de l'époque). Seuls les accents sont absents la plupart du temps, mais c'est souvent le cas dans les manuscrits de ce temps-là.
Le maire sortant, Sébastien Llech, était en place depuis 1808, donc durant toute la deuxième moitié du Ier Empire et également sous le début du règne de Louis XVIII. Peut-être a-t-il été trop favorable à la Restauration, ce qui expliquerait alors son évincement au profit de Joseph Pons Tixador. Ce dernier est lui-même révoqué dès le retour de Louis XVIII après la fin des Cent-Jours quelques semaines plus tard et remplacé par un certain Pierre Roig.
Notons que la famille Llech est à l'origine de plusieurs maires de Corbère jusqu'à la fin du 19e siècle, dont Sébastien est le premier représentant. On trouve 2 Sébastien, 2 Valentin et 1 Joseph.
Source : ADPO, 2M37
Liste des maires : MairesGenWeb
Photos : Fabricio Cardenas [cc-by-sa]
Ce blog vous intéresse ? Vous pouvez vous y abonner
en bas à droite de cette page dans la section Membres.
Cet article vous a intéressé ? Partagez-le !
en bas à droite de cette page dans la section Membres.
Cet article vous a intéressé ? Partagez-le !