Le « Radical des Pyrénées-Orientales » du 13 juin 1886 s'indigne d'un fait divers un peu particulier rapporté par l' « Écho de Cerbère ».
Un cardinal portugais, pris en flagrant délit de contrebande de tabac lors de son passage à Cerbère, se contente de recevoir des excuses suite au zèle excessif du douanier local. A contrario, un banal père de famille, se retrouvant dans la même situation deux jours plus tard, ne bénéficie quant à lui aucunement de la mansuétude de l'administration des Douanes et écope d'une amende sévère. Le principe d'égalité des citoyens face à la loi est ici manifestement sérieusement mis à mal.
On lit dans l'Écho de Cerbère :
» Mieux vaut être don José, troisième du nom, qu'un pauvre hère. Cela se conçoit aisément et vous le saisirez davantage à la lecture des quelques lignes qui vont suivre.
» Le Cardinal-patriarche de Lisbonne, dont nous avons signalé le passage à Cerbère dans notre dernier numéro, aime le bon tabac ; cela se conçoit et s'excuse chez un prélat dont l'origine doit légitimer le goût même immodéré de la plante à Nicot.
» Mais ce que l'Éminence susdite aime moins, c'est l'acquittement des droits lorsqu'elle introduit cette marchandise en France. Aussi le cardinal jugea-t-il inutile, la semaine dernière, de déclarer à l'administration qu'un kilogramme et demi d'un tabac de choix se cachait dans sa malle.
» Toutefois l'arôme qui se dégagea à l'ouverture des colis fut si pénétrant qu'un employé, amateur sans doute, fourra son nez dans le corps du délit et retira de sa cachette le précieux paquet.
» S'appeler don José III, occuper à Lisbonne une des premières places et être pincé à la frontière comme un vulgaire contrebandier, cela n'avait aucune raison d'être.
» Et effectivement, pour le bonheur des peuples, il n'en fut pas ainsi. L'Administration respectueuse condamna l'INDÉLICATESSE de l'employé trop vigilant et ce fut au milieu d'un concert d'excuses que le dignitaire portugais replaça sous son linge son odorant tabac qui passa en FRANCHISE.
» Or deux jours après cet incident un malheureux père de famille fut surpris avec une petite provision de cinq cents grammes d'un tabac ORDINAIRE qu'il avait avec lui. Mais il portait le nom le plus vulgaire et sa mise était des plus simples. La Douane ne pouvait pas hésiter.
» Et elle n'hésita pas, l'impartiale Administration, rien que la mort, c'est-à-dire rien que l'amende n'était capable d'expier ce forfait.
» Le pauvre homme offrit sa montre qu'on eut, un moment, l'idée d'accepter pour l'envoyer à don José en dédommagement de ses tribulations. Mais comme l'objet était aussi triste que l'individu, ce projet n'eut pas de suite et l'ADMINISTRATION FRANÇAISE s'en tint à l'application sommaire d'une amende de SOIXANTE FRANCS.
» C'est pourquoi on lit toujours sur nos monuments publics cette fière devise :
» Liberté, ÉGALITÉ, Fraternité. »
Deux poids et deux mesures
On lit dans l'Écho de Cerbère :
» Mieux vaut être don José, troisième du nom, qu'un pauvre hère. Cela se conçoit aisément et vous le saisirez davantage à la lecture des quelques lignes qui vont suivre.
» Le Cardinal-patriarche de Lisbonne, dont nous avons signalé le passage à Cerbère dans notre dernier numéro, aime le bon tabac ; cela se conçoit et s'excuse chez un prélat dont l'origine doit légitimer le goût même immodéré de la plante à Nicot.
» Mais ce que l'Éminence susdite aime moins, c'est l'acquittement des droits lorsqu'elle introduit cette marchandise en France. Aussi le cardinal jugea-t-il inutile, la semaine dernière, de déclarer à l'administration qu'un kilogramme et demi d'un tabac de choix se cachait dans sa malle.
» Toutefois l'arôme qui se dégagea à l'ouverture des colis fut si pénétrant qu'un employé, amateur sans doute, fourra son nez dans le corps du délit et retira de sa cachette le précieux paquet.
 |
| Le patriarche de Lisbonne don José III. |
» S'appeler don José III, occuper à Lisbonne une des premières places et être pincé à la frontière comme un vulgaire contrebandier, cela n'avait aucune raison d'être.
» Et effectivement, pour le bonheur des peuples, il n'en fut pas ainsi. L'Administration respectueuse condamna l'INDÉLICATESSE de l'employé trop vigilant et ce fut au milieu d'un concert d'excuses que le dignitaire portugais replaça sous son linge son odorant tabac qui passa en FRANCHISE.
» Or deux jours après cet incident un malheureux père de famille fut surpris avec une petite provision de cinq cents grammes d'un tabac ORDINAIRE qu'il avait avec lui. Mais il portait le nom le plus vulgaire et sa mise était des plus simples. La Douane ne pouvait pas hésiter.
» Et elle n'hésita pas, l'impartiale Administration, rien que la mort, c'est-à-dire rien que l'amende n'était capable d'expier ce forfait.
» Le pauvre homme offrit sa montre qu'on eut, un moment, l'idée d'accepter pour l'envoyer à don José en dédommagement de ses tribulations. Mais comme l'objet était aussi triste que l'individu, ce projet n'eut pas de suite et l'ADMINISTRATION FRANÇAISE s'en tint à l'application sommaire d'une amende de SOIXANTE FRANCS.
» C'est pourquoi on lit toujours sur nos monuments publics cette fière devise :
» Liberté, ÉGALITÉ, Fraternité. »
José Sebastião d'Almeida Neto (1841-1920) est un prêtre franciscain portugais devenu évêque de l'Angola et du Congo en 1879, puis cardinal-patriarche de Lisbonne en 1883-1884. Il est consacré en sus cardinal-prêtre des Saints-Apôtres le 10 juin 1886, soit à peine trois jours avant la parution de cet article. Le journal précise qu'il a repris l'information de son confrère « L'Écho de Cerbère et de Port-Vendres » (nom complet de ce journal).
Ce périodique avait une parution hebdomadaire, on peut donc supposer que le passage du cardinal à Cerbère a eu lieu au moins sept à dix jours plus tôt. Peut-être se rendait-il justement au Vatican en vue de la cérémonie le concernant. Un incident à son propos juste avant un événement aussi important aurait sans conteste été particulièrement malvenu, ceci expliquant sans doute le geste de faveur de l'administration des Douanes à son égard. Mais rien n'empêche de penser que, consécration ou pas, il aurait de toute façon bénéficié du même passe-droit (c'est en tout cas l'avis du journal).
Source : Le « Radical des Pyrénées-Orientales » du 13 juin 1886 [domaine public] (via le fonds numérisé de la Bibliothèque de Perpignan)
Crédit photo : Anonyme [domaine public]
Ce périodique avait une parution hebdomadaire, on peut donc supposer que le passage du cardinal à Cerbère a eu lieu au moins sept à dix jours plus tôt. Peut-être se rendait-il justement au Vatican en vue de la cérémonie le concernant. Un incident à son propos juste avant un événement aussi important aurait sans conteste été particulièrement malvenu, ceci expliquant sans doute le geste de faveur de l'administration des Douanes à son égard. Mais rien n'empêche de penser que, consécration ou pas, il aurait de toute façon bénéficié du même passe-droit (c'est en tout cas l'avis du journal).
Source : Le « Radical des Pyrénées-Orientales » du 13 juin 1886 [domaine public] (via le fonds numérisé de la Bibliothèque de Perpignan)
Crédit photo : Anonyme [domaine public]
Ce blog vous intéresse ? Vous pouvez vous y abonner
en bas à droite de cette page dans la section Membres.
Cet article vous a intéressé ? Partagez-le !
en bas à droite de cette page dans la section Membres.
Cet article vous a intéressé ? Partagez-le !


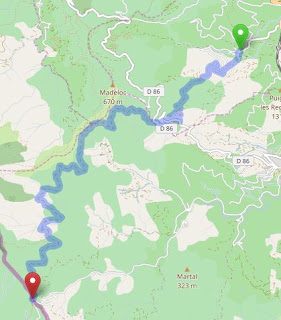









.jpg)


.jpg)


.jpg)